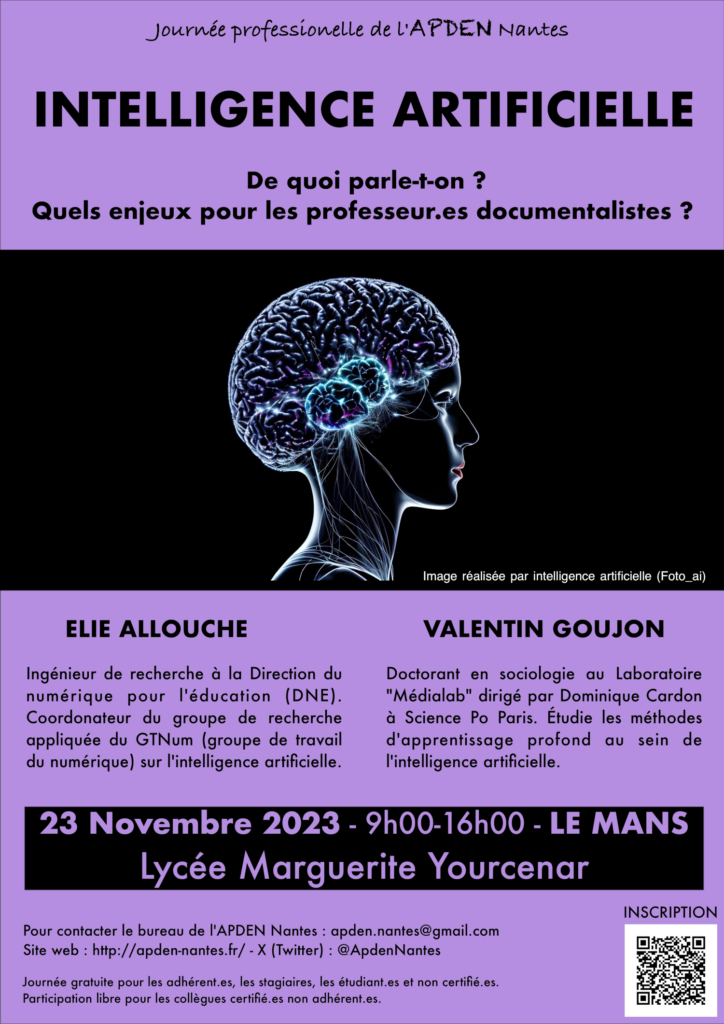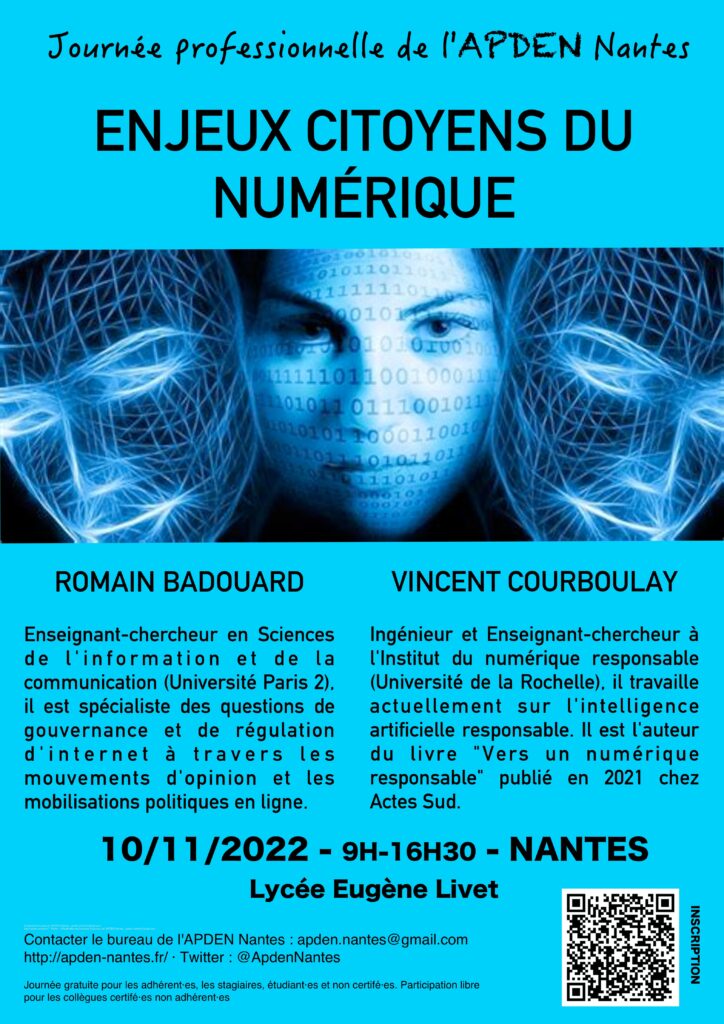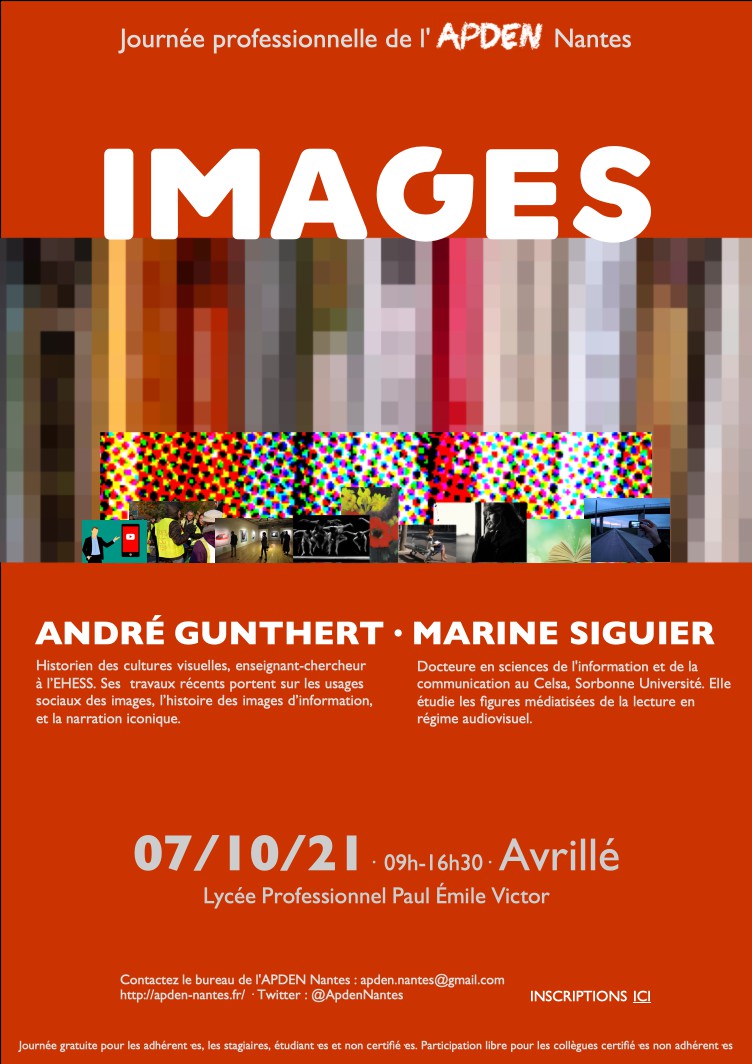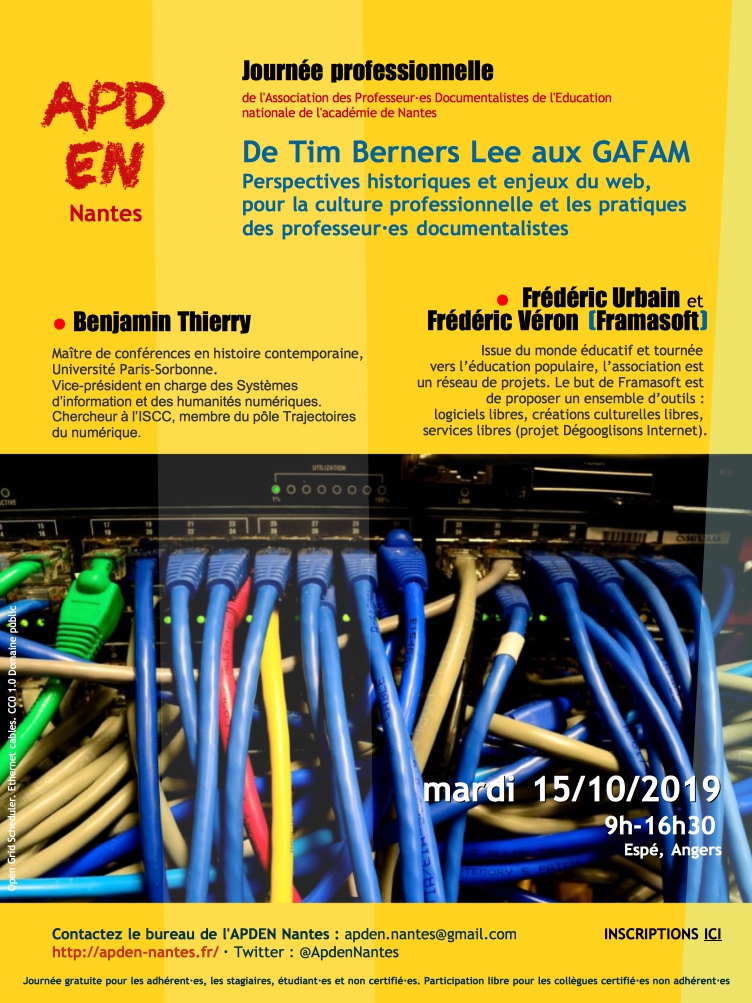Retour sur la Journée professionnelle 2024 de l’APDEN Nantes
La journée de formation a eu lieu à l’INSPE d’Angers le jeudi 21 novembre 2024 en présence d’une centaine de professeur.es documentalistes adhérent.es ou non venant de toute l’académie, malgré les conditions métérologiques difficiles ce jour-là.
Économie de l’édition et des médias d’information
Quelles sont les réponses possibles pour faire face aux phénomènes de concentration médiatique et éditoriale, aussi bien de la part des professionnel·les que des pouvoirs publics ? En quoi ceux-ci impactent-t-ils l’école et quelles réponses éducatives y apporter, notamment du point de vue des professeur·e·s documentalistes et de l’enseignement info-documentaire ?
Les maisons d’éditions et les médias d’information sont de plus en plus détenus par de grands groupes industriels, tels que Hachette pour les éditeurs ou Vivendi pour les médias d’information. Ces derniers se retrouvent en situation de quasi monopole, provoquant une marchandisation croissante de l’information et de la culture. Ce phénomène de concentration médiatique soulève des enjeux éthiques et économiques touchant à la pluralité de l’information, à la liberté d’expression, au risque de remettre en cause le bon fonctionnement démocratique de nos sociétés.
Introduction sur l’histoire du monde de l’édition de Jean-Yves Mollier, Professeur émérite à l’université Paris Saclay, spécialiste de l’histoire de l’édition.
Table ronde :
Sophie Noël, Fanny Mazzonne et André de Pétigny ont répondu aux questions relatives à l’économie des maisons d’édition en France aujourd’hui et notamment aux enjeux soulevés par la concentration de grands groupes éditoriaux détenant plus de 87% du marché de l’édition. Ils ont ainsi dressé un bref historique du phénomène de concentration sur les vingt dernières années et analysé les conséquences politiques, sociétales, économiques et éthiques d’une telle concentration. Ils ont de plus débattu sur les notions de liberté d’expression, de pluralisme du discours et de bulles médiatiques. Chacun·e des participant·es répondant à l’aune de ses recherches et en sa qualité d’enseignante ou de responsable d’association.
- Sophie Noël, Docteure en sociologie, Professeure en Sciences de l’Information et de la communication à l’Université Paris-Panthéon-Assas et membre du CARISM (Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias). L’un de ses thèmes de recherche concerne les enjeux de l’indépendance dans la filière du livre.
- Fanny Mazzone, Maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’Université de Toulouse au sein du Laboratoire d’études et de recherche appliquées en sciences sociales (LERASS). Elle enseigne, entre autres, les aspects socioéconomiques du livre et de l’édition contemporaine. Elle est spécialiste de la question du genre dans le monde de l’édition.
- André de Pétigny a dirigé pendant 20 ans les éditions indépendantes et engagées, Pourpenser, localisées en Loire-Atlantique et représente aujourd’hui la FEDEI, la fédération des éditions indépendantes. Fondée en 2021, la FEDEI compte plus de 400 maisons d’éditions adhérentes et a pour but de défendre les intérêts matériels et moraux des structures éditoriales indépendantes et de favoriser leurs échanges interprofessionnels.

Conférence Nils Solari – Association ACRIMED
L’association Acrimed a été créée en 1996 et compte à présent 1500 adhérent·es. Elle est actuellement basée à Nantes. Elle a pour but de militer pour la liberté de la presse et fait état du fonctionnement des médias, de leur financiarisation et de leurs dérives. L’association Acrimed diffuse un média appelé « Média-critiques » disponible sur le site acrimed.org. Nils Solari est également habilité EMI pour faire des interventions dans les établissements scolaires, principalement collège-lycée. L’association Acrimed met régulièrement à jour la carte des médias français « Médias français : qui possède quoi ? ». Ils en sont à leur 20ème édition (https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi). Les médias sont répartis en trois secteurs : Les médias lucratifs, les médias du secteur publique et les médias dits du « tiers-secteur ». Pour Nils Solari il faut bien avoir à l’esprit que la pluralité des médias n’entraine pas nécessairement la pluralité des idées.
- Les médias lucratifs
9 milliardaires détiennent 90% des grands médias en France (source : V. Oberti et L. Hermann – Documentaire Médiapart « Média Crash »-17 mai 2022-https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/france/le-documentaire-media-crash-sur-mediapart). C’est le journalisme « pro-business » comme décrit par Nils Solari. C’est aussi un journalisme de « Classe » car 65% des personnes qui s’expriment à la télévision (y compris l’audiovisuel publique) sont des cadres supérieurs (source : rapport de l’ARCOM, 2023). Cela entraîne une misère du journalisme social. Dans ce type de médias, le poids des annonceurs est très fort et le risque d’autocensure de la part des journalistes aussi. Quand un contenu journalistique déplaît, il existe un pouvoir publicitaire sur ce même contenu journalistique et sur le chiffre d’affaire du journal. La publication d’une information journalistique, dans ces médias, est dépendante de sa potentielle rentabilité et des contraintes commerciales qui y sont associées. Le coût de l’information y est réduit, limitant ainsi les enquêtes et les reportages qui nécessitent des temps long. Cela entraîne une précarisation du métier de journaliste. De plus, les médias lucratifs souffrent d’un biais néolibéral qui entraîne une disqualification et/ou une occultation d’une parole dissidente.
- Les médias du secteur public
Le fer de lance du secteur public de l’audiovisuel est de trouver des moyens de financement des médias. Plusieurs modes de fonctionnement existent : La vente en kiosque, les abonnements papiers et en ligne, l’impôt d’état qui remplace la redevance audiovisuelle, les aides à la presse (captées à 61% par les grands groupes médiatiques), les ressources publicitaires (Numériques, TV, etc.). Par conséquent, le maintien de la liberté d’expression des journalistes, qui est différent de la légitimité à parler dans les plateaux de certains médias, est dépendant de son mode de financement. En journalisme, il est dit que « le fait divers, fait diversion » permettant de « faire vendre » des journaux.
- Les médias du « tiers-secteur »
Ce sont des médias à but non lucratifs, indépendants, qui promeuvent un élargissement des droits d’expression à tous. Ils représentent un contre pouvoir critique et éclairé de l’information et au vu du développement d’internet et des médias participatifs. On peut citer en exemple les radios ou télévisions libres ou associatives, les médias citoyens tels que Body Blog, L’âge de faire, Disclose, Basta et Médiapart, etc.
Repères bibliographiques :
Patrick Champagne, La Double Dépendance. Sur le journalisme, Paris, Raisons d’Agir, 2016, 187 pages
Sections d’articles sur le site d’Acrimed :
Économie des médias et publicité… Tout ne s’explique pas par l’économie, mais rien ne s’explique sans elle : https://www.acrimed.org/-Economie-et-publicite-
Construction médiatique de l’opinion économique… La pensée de marché: https://www.acrimed.org/-Construction-mediatique-de-l-opinion-economique-
Journalisme économique : https://www.acrimed.org/+-Journalisme-economique-+
Économie…La pensée de marché et ses pédagogues : https://www.acrimed.org/-Economie-